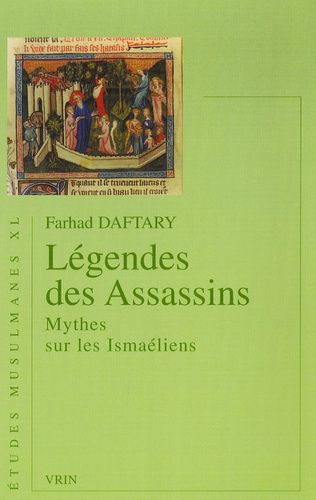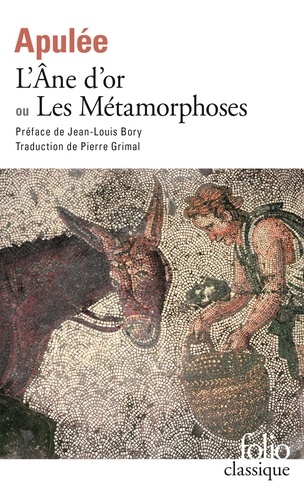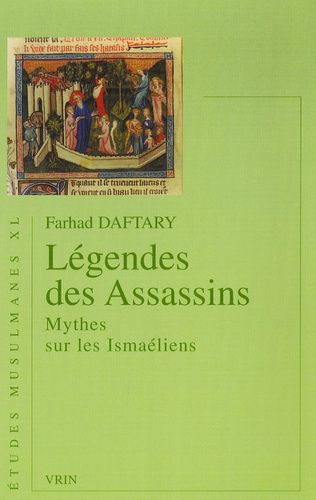
Farhad DAFTARY, Légendes des Assassins : mythe sur les Ismaéliens, Librairie philosophique J. Vrin, 2007
Recension du livre par Michel Boivin sur le site de de l'Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM) :
"Farhad Daftary, actuellement directeur adjoint chargé du département de recherche et des publications de l’Institute of Ismaili Studies à Londres, est un spécialiste reconnu de l’ismaélisme médiéval. On lui doit une somme historique dont la version abrégée a été traduite en français par Zarien Rajan-Badouraly, qui est aussi la traductrice du présent ouvrage1. Il est également l’auteur d’une très utile bibliographie de l’ismaélisme publiée en 20042. La Légende des Assassins, dont le texte original a été publié en 1994, se compose d’une étude de Farhad Daftary (« Légendes des Assassins », p. 17-134) et d’une édition annotée du fameux « Mémoire de Silvestre de Sacy sur les Assassins » (p. 135-189) brièvement introduite. Le texte de Daftary est découpé en trois chapitres: les ismaéliens dans l’histoire et dans les textes (p. 25-62), les perceptions européennes médiévales de l’islam et de l’ismaélisme (p. 63-98), et l’origine et la formation des légendes (p. 99-134).
L’objectif de l’auteur est « de remonter aux origines de la plus célèbre des légendes médiévales qui entourent les ismaéliens nizârites et d’étudier les circonstances au cours desquelles ces légendes se sont si largement répandues » (p. 18). Comme il le rappelle, il s’agit ici d’un cas rare mais extrêmement significatif puisque ces légendes et ces mythes ont donné naissance à un terme, assassin, utilisé par une grande partie des langues de l’Europe occidentale pour désigner « celui qui commet un meurtre avec préméditation » (Petit Robert). L’histoire de ces ismaéliens, une branche minoritaire du chiisme, est exemplaire à bien des égards mais elle témoigne avant tout de la force de manipulation des États constitués contre les minorités. Elle indique en outre comment un exotisme débridé peut donner naissance aux fantaisies les plus délirantes. Car si Daftary démontre que le mythe des Assassins a bien été colporté par les historiens des croisades en Europe, avant d’atteindre sa forme paroxystique avec Marco Polo, il insiste avec raison sur les circonstance spécifiques qui ont incité les Assassins à mettre en œuvre une politique d’assassinats politiques, dont ils sont par ailleurs loin d’être les inventeurs.
Dans la première partie, Daftary revient sur les premiers siècles de l’islam. Ce rappel est utile car il indique que la question de l’autorité religieuse en islam fut très longue à être réglée après la mort de Muhammad, et surtout qu’aucun règlement ne fit l’unanimité. Les chiites élaborèrent leur propre conception d’après laquelle « l’humanité a un besoin permanent d’être guidée par un dirigeant ou imam inspiré par Dieu, pur et infaillible qui, à la suite du Prophète Muhammad, professerait un enseignement faisant autorité et guiderait les hommes dans les domaines spirituels et religieux » (p. 30). Après la mort du sixième imâm Ja`far al-Sâdiq en 765, des fidèles choisirent son fils Ismâ`îl comme imâm, d’où leur nom d’ismaéliens. Jusqu’en 899, les ismaéliens formaient un mouvement unifié qui proclamait que Muhammad b. Ismâ`îl était le mahdî mais, à cette date, `Abd Allah (ou Udayd Allah) al-Mahdî se proclama imâm. Cette proclamation entraîna une scission avec d’un côté les ismaéliens qui le reconnurent comme imâm et d’un autre côté ceux qui rejetèrent cette prétention. En 910, `Abd Allah al-Mahdî fonda le califat fatimide en Ifriqyya, avant que ses successeurs ne le transfèrent en Égypte en 973.
Si la phase impériale de l’ismaélisme est considérée comme son âge d’or, Daftary rappelle à bon escient que la « légende noire » qui donnera naissance au mythe des Assassins se constitue dès cette époque. Ce n’est pas un hasard si c’est lorsque le califat fatimide du Caire défie le califat abbasside de Baghdad qu’une telle légende est élaborée. Les Fatimides prendront le contrôle de Baghdad pour une brève période en 1058-1059. Dès le milieu du Xe s., Ibn Rizam et Akhu Muhsin décrivent l’ismaélisme comme « une conspiration secrète cherchant à abolir l’islam » (p. 42). Les hérésiographes, dont le célèbre al-Baghdadi (m. 1037), excluent les ismaéliens de la communauté musulmane. Cette première strate fournit une matière où les chroniqueurs des croisades allaient puiser, suivis par les orientalistes. Daftary souligne avec justesse le paradoxe entre cette représentation et l’essor de la production philosophique mais aussi historique qui caractérise l’empire fatimide. Puis en 1094, le califat fatimide est marqué par un schisme provoqué par une querelle de succession successive au décès du calife-imâm al-Mustansir. Un parti minoritaire choisit son fils Nizâr : on les appellera les nizârites. Mais c’est finalement un autre fils, al-Musta`li, qui deviendra calife. C’est sous le règne de ce dernier que les croisés s’empareront de la Jérusalem fatimide en 1099. Les nizârites se réfugieront dans les montagnes de Syrie et de Perse. Le fils et successeur d’al-Musta`li, al-Amir, utilisera pour la première fois le terme « hashishiyya » dans une réfutation des nizârites en 1123 (p. 47). L’empire et le califat fatimides seront détruits par Saladin en 1171.
La deuxième partie concerne les perceptions européennes médiévales de l’islam et de l’ismaélisme. Elle se concentre surtout sur la description des premières représentations de l’islam et des musulmans, ainsi que sur les relations historiques, en opposition avec les représentations, entre croisés et ismaéliens. Tancrède (m. 1112), prince d’Antioche, fut le premier à entrer en relations avec eux. Un peu plus tard, un chef ismaélien alla jusqu’à demander l’asile au roi de Jérusalem Baudoin III (m. 1131). En fait, à bien y regarder, il n’y a à rien là de surprenant. Un rapprochement entre croisés et « hérétiques » musulmans était tout à fait naturel pour résister aux nouvelles forces du Proche-Orient comme les Mamlouks. C’est dans ce contexte que les chroniqueurs des croisades commencèrent à rassembler et coucher par écrit des informations sur les ismaéliens. Cette situation fut mise à rude épreuve en 1192, avec l’assassinat de Conrad de Montferrat, alors qu’il s’apprêtait à se faire couronner roi de Jérusalem. Les motifs en sont obscurs et rien ne prouve vraiment que les ismaéliens en aient été les auteurs. Une nouvelle période de rapprochement commence entre les ismaéliens et les Hospitaliers, puis avec les Templiers, qui conduit le prince d’Antioche à s’en plaindre auprès du pape. C’est avec Saint Louis (m. 1270) que ce rapprochement atteint cependant son apogée. Alors que la situation des croisés était des plus délicates, le roi de France envoya un émissaire pour rencontrer le « Vieux de la Montagne », en l’occurrence le chef des ismaéliens de Syrie. Un épisode intéressant a été rapporté par Joinville (1224-1317), le chroniqueur de Saint-Louis. L’émissaire du roi était un moine arabophone nommé Yves Le Breton. Celui-ci découvrit que les ismaéliens ne vénéraient pas Mahomet mais Ali. Il découvrit également que le livre de chevet du Vieux de la Montagne était un florilège des paroles de Saint-Pierre.
La troisième partie sur l’origine et la formation des légendes est la plus novatrice. Après avoir démontré son origine indubitablement européenne, Daftary établit qu’en terre d’islam, le terme de « hashishiyya » était employé comme une insulte signifiant des « exclus sociaux irréligieux » ou des « agitateurs de basse classe » (p. 103). Les sources islamiques infirment complètement tous les éléments du mythe des Assassins. L’un des thèmes les plus récurrents est « la légende du paradis » : le chef aurait promis aux assassins de leur accorder le paradis sur terre après leur mission. Grâce à sa connaissance de l’ismaélisme, l’auteur identifie aisément les origines cette légende du paradis : la Grande Résurrection qui fut proclamée par l’imâm ismaélien Hasan II alâ dhikrihi’l-salâm en 11643. Un autre élément du mythe décrit le Vieux de la Montagne, le chef des ismaéliens de Perse cette fois, vivant dans une sorte de jardin des délices. Or les auteurs musulmans, souvent hostiles aux ismaéliens, s’accordent pour affirmer que Hasan Sabbâh, le chef suprême des ismaéliens nizârites, mena une vie ascétique et rigoriste. L’explication de Daftary repose sur l’idée de martyre, qui était connue des musulmans de cette époque]. Pour les musulmans de cette époque, nul n’était besoin de recourir à des explications irrationnelles pour expliquer le comportement des sacrifiants ismaéliens. Puis Daftary retrace l’historique de la construction du mythe, pierre par pierre. Il observe que les Européens qui ont fait des séjours de longue durée au Proche Orient n’ont jamais contribué à la formation du mythe. Ce sont les chroniqueurs de passage qui ont glané des rumeurs et des légendes.
Le mythe des Assassins connut un essor considérable lorsque les relations directes entre Européens et ismaéliens furent rompues, après leur départ du Proche-Orient. Ce n’est pas un hasard si c’est à cette époque qu’apparaît la forme la plus élaborée du mythe : la version de Marco Polo (1254-1324). Le voyageur vénitien reprend et développe les principaux éléments qui structurent le mythe, dont le fameux thème du paradis. Pourtant, aucun des historiens qui connurent les ismaéliens d’Alamut n’y fait allusion. Quelqu’un comme Juwayni visita pourtant le site en 1256, peu avant sa destruction par les Mongols. En outre, Marco Polo réalise une sorte de collage entre les informations qu’il a recueillies sur les ismaéliens de Syrie et celles qui concernent les ismaéliens de Perse. Le plus intéressant est cependant que le mythe des Assassins provoqua un tel engouement en Europe qu’on leur consacra des monographies, un fait unique dans cette période de balbutiements de l’orientalisme. Les ismaéliens n’avaient en effet jamais constitué une force par le nombre ou la puissance militaire, hormis l’épisode fatimide définitivement clos au XIIe s. La première de ces monographies est publiée en français en 1603 par Denis Lebay de Batilly (p. 130). Avec la célèbre Bibliothèque orientale de Barthélémy d’Herbelot (1625-1695), les Assassins sont enfin situés au sein de l’islam : ce sont des chiites ismaéliens. Les deux branches de l’ismaélisme, les Fatimides et les nizârites, sont identifiées.
L’institutionnalisation de l’orientalisme ne favorise pas une lecture critique du mythe. Bien qu’utilisant des sources arabes, Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838) adopte la perspective des hérésiographes sunnites : le chiisme, et plus particulièrement le chiisme ismaélien, est pour lui un mouvement nihiliste qui vise à la destruction de l’islam. Daftary ne s’attarde pas sur l’éclatement du mythe, lorsque les orientalistes commencent enfin à traduire des textes ismaéliens… que Silvestre de Sacy avait reçus puis oubliés dans un tiroir… Il ne cite pas le nom de Stanislas Guyard (1846-1884), le précurseur, ni la Bibliographie qarmate que Louis Massignon (1883-1962) publia onze ans avant A Guide to Ismaili Literature de Wladimir Ivanow (1886-1970). Il est plus surprenant de constater qu’il ne mentionne pas non plus Henry Corbin (1903-1978).
Enfin, le plus difficile à comprendre dans ce dossier est non pas comment les premiers orientalistes ont emboîté le pas aux hérésiographes sunnites et aux chroniqueurs des croisades, projetant les fantasmes de complots propres à leur époque, mais comment des spécialistes contemporains ont pu reprendre à leur compte une telle perspective. Dans son livre consacré aux Assassins, Bernard Lewis ne manque pas d’ajouter dans le sous-titre le terme terrorisme4. Sans parler de la presse et des publications grand public qui, à chaque explosion terroriste venue du Moyen Orient, ressasse que la violence est inhérente à l’islam, comme le prouve l’existence des …Assassins5.
Michel Boivin
Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du sud (CEIAS), EHESS/CNRS
___________________________
Farhad Daftary, The Ismâ`îlîs : Their history and doctrines, préface de Wilferd Madelung, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; version abrégée A short history of the Ismailis. Traditions of a Muslim community, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1998, tr. fr. Les Ismaéliens. Histoire et traditions d’une communauté musulmane, préface de Mohammed-Ali Amir-Moezzi, Fayard, 2003.
Farhad Daftary, Ismaili Literature. A Bibliography of Sources and Studies, London, I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies, 2004
Par la Grande Résurrection (qiyâmat al-qiyâmât), l’imâm abolit le règne de la loi islamique (charia) et instaura une communauté unie par le seul impératif de contempler en l’homme parfait la face visible de la divinité, c’est-à-dire de vivre ici-bas la vie divine réservée aux élus du Paradis. Sur la Grande Résurrection, on lira les pages pénétrantes de Henry Corbin dans « Huitième centenaire d’Alamût », Mercure de France, février 1965, p. 285-304 et le livre de Christian Jambet, La grande résurrection d’Alamût. Les formes de la liberté dans le shî`isme ismaélien, Lagrasse, Verdier, 1990.
Bernard Lewis, Les Assassins. Terrorisme et politique dans l’islam médiéval, tr. de l’anglais par Annick Pélissier, présentation de Maxime Rodinson, Paris, Berger Levrault, 1982 (éd. or. 1967).
La dernière publication de ce genre est l’ouvrage de W. B. Bartlett, The Assassins : The Story of Medieval Islam’s Secret Sect, Stroud (Gloucestershire), Sutton Publishing, 2001."
Dernière mise à jour : 9 novembre 2009